Par Mathieu Gotteland, docteur en histoire, Analyste et Rédacteur chez IPSA.
La Somalie, prototype de l’État failli, épouvantail africain pour les pays : Tchad, Centrafrique, Nigéria, et tant d’autres, dont on craint régulièrement la somalisation[1], est le pays d’Afrique le plus touché par la violence politique et les catastrophes naturelles. 2022 marque une aggravation sans précédent des crises internes mais semble aussi laisser une lueur d’espoir, après l’assermentation des députés, l’élection du président Hassan Cheikh Mohamoud et la nomination du premier ministre Hamza Abdi Barre. Par ailleurs, les dernières semaines ont été marquées par une vaste offensive anti-shebab qui semble porter des fruits, malgré un coût important en vies humaines.
À quelles crises sous-jacentes la Somalie doit-elle faire face ? Quelles sont les causes de la violence et les mécanismes de la violence politique dans ce pays ? Quel est le rôle des acteurs extérieurs dans la (dé)stabilisation de la Somalie ? Quelles sont enfin les perspectives à court et moyen terme pour la lutte contre l’insécurité, la construction de l’État et le développement humain ?
Contextualisation historique
La côte somalienne, aujourd’hui encore presque exclusivement de confession sunnite et d’obédience ou shafi’i ou soufie, se convertit à l’islam dès le IXe siècle par le biais du commerce. Elle est située sur une route maritime de première importance, entre mer Rouge et océan Indien, ce dont elle tire profit de puis l’Antiquité. On émet en effet l’hypothèse que le mythique pays désigné par les anciens Égyptiens sous le nom de Punt serait situé au nord de l’actuelle Somalie. Comme ailleurs en Afrique, les frontières modernes sont l’héritage du partage entre les puissances colonisatrices : Somalie italienne (centre et sud), britannique (actuel Somaliland), français (côte des Afars et Issas, aujourd’hui Djibouti). Le Somaliland britannique et italien, indépendants respectivement les 26 juin et 1er juillet 1961, s’unissent pour former l’actuelle Somalie. L’Ogaden, région éthiopienne de population somalie, conquis par l’Italie en 1936 et rattaché à sa colonie somalienne, est lui adjugé à l’Éthiopie par la jeune ONU. Dès 1969, un coup d’État militaire met à mal la jeune république unifiée et place Mohamed Siyad Barre à la tête du pays. Ce dernier tente de réconcilier islam politique et marxisme. Néanmoins, le soutien soviétique et cubain à l’Éthiopie lorsque la Somalie de Barre déclenche l’invasion de l’Ogaden l’engage à chercher en Amérique un soutien plus ferme à son autorité. Les guérillas et les résistances soutenues par l’Éthiopie et la Libye provoquent en 1991 la fin de la dictature, mais aussi l’effondrement de l’État central, qui n’est pas encore réparé aujourd’hui, ainsi que la sécession du Somaliland (nord). Se succèdent avec des fortunes diverses et dans un contexte de guerre américaine contre le terrorisme le Gouvernement national de transition (2000), le Gouvernement fédéral de transition (2004), puis la République fédérale de Somalie (2012). Un agenda de politique étrangère indépendante, pour la première
Ce contenu est réservé aux abonnés
Connectez-vous pour avoir un accès complet ou abonnez-vous dès maintenant !




















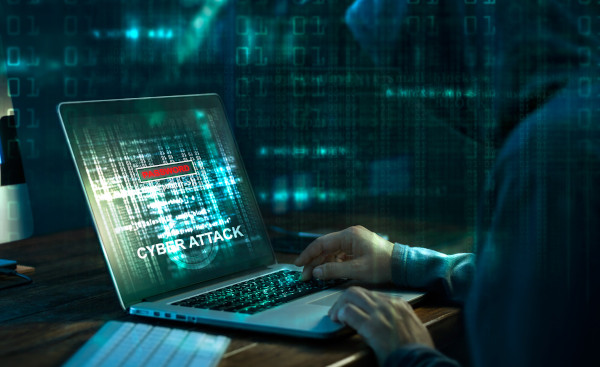

Commenter